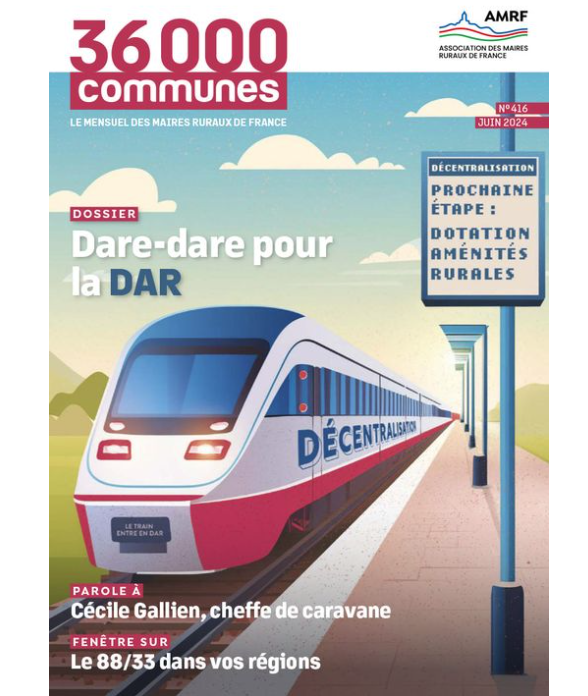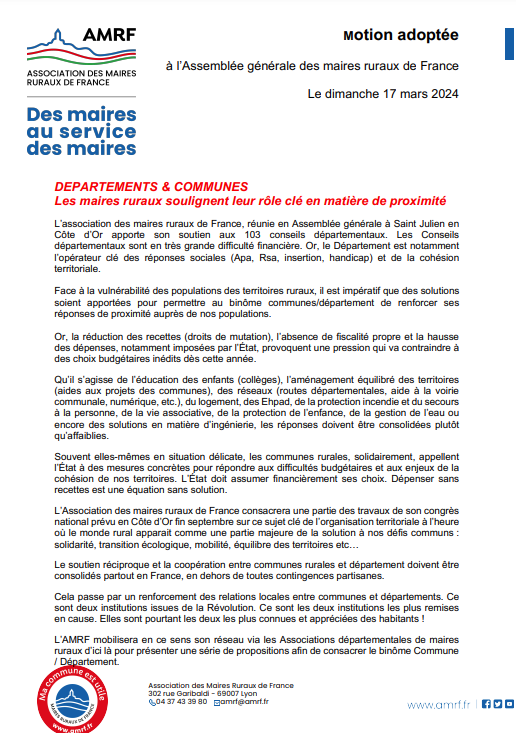Voici un Podcast écrit par le Président de l’AMR 85 Denis La Mache et publié sur RCF Radio :
Les résultats de Parcoursup tombent progressivement depuis le début du mois de juin. La plateforme d’affectation à l’enseignement supérieur est redoutée par beaucoup de bacheliers… parfois même, bien plus que le bac lui-même à en croire un récent sondage. Il n’échappe à personne (et surtout pas aux jeunes concernés) que la redoutable plateforme détermine leur formation, leur lieu d’études et, au final, leur orientation professionnelle. Mais que donne cette mystérieuse loi des algorithmes sur nos jeunes ruraux ? Une enquête pilotée par France info sur ce sujet mérite toute notre attention.
Il en ressort que de nombreux jeunes ruraux ont choisi de ne faire aucun vœu dans les métropoles ou d’y refuser des admissions. Les raisons sont multiples. Il y a d’abord la question du logement. Avec l’inflation actuelle et un marché locatif en tension, le financement des études constitue une difficulté supplémentaire pour les familles qui vivent loin d’une grande ville. « C’est un frein identifié depuis longtemps, mais il ne cesse de se renforcer. C’est d’ailleurs ce que confirme Margot Lecœur, présidente de la fédération Des territoires aux grandes écoles, qui regroupe 52 associations locales pour l’égalité des chances en milieu rural dont l’une « de la Vendée au grandes ecoles » fondée en 2019 par des vendéens, étudiants ou diplômés de Grandes Écoles.
D’après une étude de 2019 de la Fondation Jean-Jaurès, “52 % des foyers ont la possibilité de financer un logement en dehors de la région du jeune”, un chiffre qui “descend de huit points pour les foyers ruraux”. Un avis du Conseil économique, social et environnemental de 2017 rappelle lui aussi que, pour les jeunes ruraux, “l’aspect financier est un frein à la poursuite des études supérieures, notamment quand elles nécessitent le départ du foyer familial”. Si les lycéens vivant dans une grande agglomération peuvent aussi être amenés à déménager pendant leurs études, les cas sont plus limités, en raison d’une offre de formations plus fournie dans leur ville d’origine d’une part et de la sectorisation des universités d’autre part. Il existe des inégalités territoriales d’accès à l’enseignement supérieur puisque, comme le rappelle un rapport de la Cour des comptes publié en février 2023 le taux de diplômés réduit globalement à mesure qu’on s’éloigne des grandes villes.
Samuel
à franceinfo
Après la question du logement vient celle de la vie quotidienne. “Les étudiants qui habitent chez leurs parents n’ont généralement pas besoin de se nourrir seuls. Pour les autres, le budget alimentation a considérablement augmenté. À cela s’ajoute le fait qu’ils passent des hypermarchés de campagne aux supérettes de centre-ville”, où les prix sont déjà plus élevés.
Autre ligne de dépenses pour ces jeunes déracinés de leur terroir : les transports. “Les coûts ont explosé ces dernières années. Alors que cela reste important à leurs yeux de rentrer, les boursiers ne peuvent souvent se le permettre qu’à l’occasion des vacances”, affirme la présidente des Territoires aux grandes écoles.
Au-delà de la question du portefeuille, les ambitions des jeunes ruraux sont freinées par d’autres obstacles. Les travaux de Clément Reversé, sociologue au centre Emile-Durkheim de Bordeaux, mais également ceux de l’INJEP montrent qu’au-delà du coût économique il y a un coût social, émotionnel et affectif.
Helena
à franceinfo
Entre peur du décalage et sentiment d’illégitimité, de nombreux lycéens ruraux s’autocensurent au moment de faire leurs vœux. Parfois, les réticences viennent aussi des proches comme le remarque Clément Reversé. “Il y a des familles qui insistent clairement sur le fait que partir, c’est enclencher une forme de rupture”. Et puis, débarquer de son village natal dans une métropole peut aussi être perçu comme un “changement de milieu social” et donc comme une “trahison”. »
À ces biais propres aux ruraux s’ajoute souvent le sentiment de ne pas avoir été suffisamment informé des possibilités d’orientation. D’après la Fondation Jean-Jaurès, ce ressenti est partagé par 42 % des jeunes de zones rurales, contre 32 % pour les jeunes d’agglomération parisienne.
Conséquence finale : un lycéen parisien à 3 fois plus de chance d’intégrer une grande ecole qu’un jeune vendéen et la part de diplômés titulaires d’un master ou d’un doctorat est « deux fois plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain (7,3 % contre 15,4 %).
Mais, pour Clément Reversé, rester dans sa région d’origine et faire des études plus courtes peut aussi être un choix assumé, mûri et stratégique : “On pourrait conclure que les ruraux manquent d’ambition professionnelle. En réalité, ils ont un rapport pragmatique entre formation et emploi, le tout en lien avec leur territoire. Ils anticipent leur insertion professionnelle qu’ils relient à un milieu de vie, et ce bien plus concrètement que les urbains.